Jean Giono. « La machine tue les hommes, la joie, l’équilibre et la civilisation »
Ces temps d’incertitude généralisée nous renvoient vers des penseurs et écrivains des profondeurs humaines. C’est bien le cas de Jean Giono, auteur universel s’il en est, parfois encore expédié dans l’arrière-cour des écrivains régionalistes – en l’occurrence le provençalisme, et quand bien même ! comme si c’était déchoir que de parler droit debout, enraciné dans la terre profonde, la Terre-mère, entière parcelle de l’univers. D’où ces mots en paradoxe : « Il n’y a pas de Provence. Qui l’aime aime le monde ou n’aime rien » (1939). Quant à l’extrait qui suit, il provient de son livre antérieur (1937), Les Vraies richesses. Il y oppose la vie paysanne à la société industrielle capitaliste, la ville et le machinisme. Sa résonance demeure tout aussi universelle et ô combien actuelle.
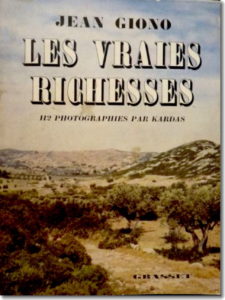 [dropcap]«[/dropcap][…] Pendant ce temps, d’autres « contingentent » et « dénaturent ». Ce qui devrait être abondant, gratuit, répandu sur la terre comme le limon des fleuves, ils le contingentent, ils le retiennent, le serrent dans des murs de béton, dans de gros coffres-forts à blé, ils l’enferment, ils poussent les gâches des grosses portes. Ils disent : « Ah ! enfin, c’est en sûreté. C’est des sous, ça sera des sous l’an prochain, plus tard, mais pour l’instant je suis tranquille, c’est enfermé ! » Ils disent ça pendant que sur la terre des gens se sacrifient pour avoir un morceau de pain. J’appelle se sacrifier être par exemple employé dans une banque et écrire des chiffres sur du papier — ce que j’ai fait moi-même pendant dix-sept ans et je ne savais pas quelle était la couleur de la campagne à quatre heures de l’après- midi — ou par exemple être apprenti chez Renault comme le petit Bob qui vient de vivre avec moi dix jours dans la montagne et qui pleure en pensant à son retour à l’atelier (il a seize ans et il est l’aîné de cinq enfants et il doit perdre sa jeunesse dans une tôlerie automobile pour gagner un peu de cette farine contingentée). Et d’autres ! Sans parler, me direz-vous, de ceux qui ne mangent pas et qui ont faim mais qui ne travaillent pas parce qu’il n’y a pas de travail (et ici je fais une petite parenthèse et je m’arrête de marcher dans le pré, pour prendre un morceau de papier et un crayon pour marquer une chose à laquelle il faudra que je pense tout à l’heure et la voilà : je n’aime pas le travail. Ça n’est pas une gloire, c’est une obligation. S’il y a moins de travail pour les hommes maintenant, c’est qu’il y a des machines. Mais, tant que le blé, le moyen de vie ne sera pas gratuit et abondant comme le limon des fleuves et le sable de la mer, la machine tuera les hommes, la joie, l’équilibre et la civilisation même d’où elle sort. […] »
[dropcap]«[/dropcap][…] Pendant ce temps, d’autres « contingentent » et « dénaturent ». Ce qui devrait être abondant, gratuit, répandu sur la terre comme le limon des fleuves, ils le contingentent, ils le retiennent, le serrent dans des murs de béton, dans de gros coffres-forts à blé, ils l’enferment, ils poussent les gâches des grosses portes. Ils disent : « Ah ! enfin, c’est en sûreté. C’est des sous, ça sera des sous l’an prochain, plus tard, mais pour l’instant je suis tranquille, c’est enfermé ! » Ils disent ça pendant que sur la terre des gens se sacrifient pour avoir un morceau de pain. J’appelle se sacrifier être par exemple employé dans une banque et écrire des chiffres sur du papier — ce que j’ai fait moi-même pendant dix-sept ans et je ne savais pas quelle était la couleur de la campagne à quatre heures de l’après- midi — ou par exemple être apprenti chez Renault comme le petit Bob qui vient de vivre avec moi dix jours dans la montagne et qui pleure en pensant à son retour à l’atelier (il a seize ans et il est l’aîné de cinq enfants et il doit perdre sa jeunesse dans une tôlerie automobile pour gagner un peu de cette farine contingentée). Et d’autres ! Sans parler, me direz-vous, de ceux qui ne mangent pas et qui ont faim mais qui ne travaillent pas parce qu’il n’y a pas de travail (et ici je fais une petite parenthèse et je m’arrête de marcher dans le pré, pour prendre un morceau de papier et un crayon pour marquer une chose à laquelle il faudra que je pense tout à l’heure et la voilà : je n’aime pas le travail. Ça n’est pas une gloire, c’est une obligation. S’il y a moins de travail pour les hommes maintenant, c’est qu’il y a des machines. Mais, tant que le blé, le moyen de vie ne sera pas gratuit et abondant comme le limon des fleuves et le sable de la mer, la machine tuera les hommes, la joie, l’équilibre et la civilisation même d’où elle sort. […] »
Jean Giono, Les Vraies richesses< (éd. Grasset).

Giono a eu au moins un précurseur sur le chemin des vraies richesses : Henry David Thoreau (1817 – 1862) connu en particulier pour son Walden ou La vie dans les bois (1854).
C’est vrai, Thoreau nous entraîne dans un monde rêvé et ce qu’il écrit est magnifique mais impossible à vivre réellement.
Giono fait des petits moments de vie réelle de la joie accessible à tout le monde…
Je les aime tous les deux.
Deux amis sur le chemin de vie.
De bien plus imprégnés que Thoreau, entre autres : Robert Hainard (Le Miracle d’être), Henri Vincenot (Prélude à l’aventure). En plus romanesque, mais quand même : Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, et d’autres comme Maurice Genevoix, Rousseau, Hugo.
Sans oublier L’Homme qui plantait des arbres de qui on sait… Magnifique Elzéard Bouffier (Giono a dû démentir son existence, tant on lui demandait de ses nouvelles…)